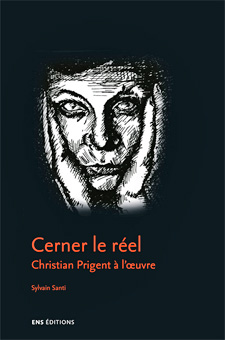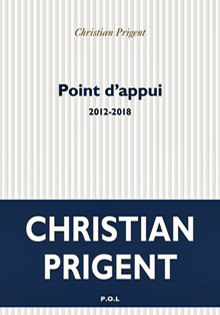L E S P O È T E S À R É A C T I O N
1
En 1924, Picabia imagine un « thermomètre-Rimbaud » : introduit au bon endroit, cet appareil mesure la fièvre poétique d’une œuvre à l’aune de celle de Rimbaud. À cet examen, les dadaïstes pètent le plafond de la graduation, l’épigone mondain Jean Cocteau caille sous zéro.
Un siècle après, le thermomètre utilisé dans le milieu des poètes est gradué différemment : il ne mesure plus une fièvre d’invention verbale mais une conformité hygiénique à des prescriptions morales ou civiques.
C’est un effet, parmi d’autres nettement plus dramatiques, de la réaction qui ne cesse d’aggraver les conséquences de la Restauration anti-moderne des années 1980.
L’ordre poétique aujourd’hui politiquement correct dit :
A/ La poésie sera « éco-poésie », ou ne sera pas. Consciente des enjeux écologiques, elle fera de cette conscience sa raison de parler. Elle sera donc de son temps. Mais renouera aussi avec sa vocation pastorale et sa tradition de sensibilité au bucolique. Elle s’y ressourcera après des décennies de formalismes maniérés et d’abstractions fumeuses. Et elle sera jugée sur ce critère : l’éco-poétique, nous prévient-on, évalue « les textes et les idées en fonction de leur cohérence et de leur utilité en tant que réponse à la crise environnementale »[1].
B/ Outre qu’utile (et pour l’être plus), le poème devra être « intéressant » et partager généreusement sa dose de sensible. Il sera d’humeur commode, son éthique sera bienveillante et égalitaire[2]. Faute de quoi, son horizon d’utilité pratique se bouchera, ennuagé d’intellectualité barbante et de rhétorique biscornue. La prescription (la commande sociale) est donc : soyez attentifs au commun (à ce à quoi s’intéressent « les gens »), repérez les contenus sociétaux aujourd’hui intéressants, mettez-les en langue discrètement poétique et popularisez efficacement les résultats. Adieu, du même coup, et une bonne fois pour toutes, à la tradition moderniste (élitisme avant-gardiste, spéculations théoriques obscures, travail maniaque sur la langue, lubies « textualistes »…).
C/ Contenu correctement éco-poétique + messagerie militante sans difficulté rébarbative = ambiance cool. Le poète ? – un soignant (applaudissements). La poésie ? – un médicament contre les blessures réelles et symboliques que le monde (la cruauté socio-politique et la déroute de la pensée devant cette violence) inflige au monde (aux hommes privés d’avoir, de pouvoir, de sens et de jouissance). C’est en finir, également (mais c’est au vrai la même chose), avec les forcenés du « négatif », les obsédés du « mal », les pervers textuels polymorphes, les maniaques du « cap au pire », les remueurs du couteau poétique dans les plaies du chromo idéologique. Il y a des auteurs (Sade, Ducasse, Joyce, Kafka, Bataille, Artaud, Genet, Beckett…) que les poètes ne nomment désormais que pour se faire peur et qui ne sont plus pour les critiques de poésie que des croquemitaines exotiques ou obsolètes.
2
Que « l’homme habite en poète[3] » est le mantra de l’enthousiasme éco-poétique.
On en fait la devise d’un retour à la poésie pastorale[4].
Voire : un slogan riche en supplément d’âme pour manif écologiste[5].
Souvent, ça prend un ton impératif : habite donc en poète ! (= cesse de faire le mariole prosaïque et brutal, le ravageur des flores, la terreur de la faune).
Ou alors ça fait s’attendrir sur une image humiliée mais réconciliée de l’homme : si peu distinct au fond de la bête, à tu et à toi avec les arbres, décidément océanique, familier du cosmos.
Que dit en fait Hölderlin ?
L’homme habite la terre d’une façon particulière : qui n’appartient qu’à lui, à laquelle seul il appartient.
Cette façon est « poétique » : l’homme n’habite la terre qu’en y bâtissant sa demeure de langue.
Ce n’est pas une sinécure (Hölderlin : « le plus terrible des biens, la Parole, à l’homme donné ») : ça isole dès que ça installe.
Si le parlant approche la terre, ce n’est qu’à l’abri du bâti des mots (Hölderlin : « So birgt der Dichter » : c’est ainsi que le poète s’abrite, et abrite autrui). Il vit derrière ces murs, dans l’espace mesuré par la puissance de nomination dont ils le dotent (Hölderlin dit que la terre, au contraire, est sans mesure : « Giebt auf Erden ein Maß ? / Es gibt keines »[6]).
Soit : habiter « poétiquement » n’est pas adhérer à la terre, se confondre avec elle, se fondre en elle. C’est s’y reconnaître étranger : maintenu à la distance à quoi contraint le fait que nous nous la représentons, que nous la parlons, que nos fictions y créent des mondes.
Hölderlin, encore : « Der Mensch […] / Von der Natur getrennt / Als wie allein ist er im anderen weitem Leben ».
Je traduis vite fait : « seul dans la vaste vie, séparé de la nature : l’homme ».
3
Ce qui gêne les parlants aux entournures de la pensée, c’est l’intuition que leurs vies sont formées et hantées par une é-normité qui échappe à la médiation symbolique.
Cette é-normité (cf. Hölderlin, ci-dessus), nul ne peut la représenter : il n’est de représentation que limitée par ses codes (ses mesures).
Il n’existe donc de cet excès aucune représentation juste.
Pourtant c’est au rêve de cette justesse que s’accrochent les pensées et les œuvres des hommes.
L’histoire de l’art est l’histoire de cet acharnement.
Faire poésie : tenter de styliser un peu d’infini – de mettre dans le fini des représentations verbales un peu plus d’infini que ne le fait la moyenne des écrits.
Ce n’est pas qu’un vœu pieux, qu’une spéculation métaphysique fumeuse.
C’est ce que fait, concrètement, toute opération un peu sérieuse de poésie.
Langage poétique veut dire, a minima : hésitation calculée, passage de son à sens et vice versa (cf. Mallarmé), polysémie maintenue (cf. les « étyms » d’Arno Schmidt), découplage prosodie/sémantique, glissements de phrase à phrasé, désarticulations et flottements syntaxiques, emportement rythmique de l’énonciation, dédoublement des significations par dissémination syllabique, anagrammes ou hypogrammes subliminaux[7].
Autant de façons de franchir des limites, de faire vaciller la représentation, de mettre un peu d’infini dans le fini – et de faire par ce biais « effet de réel » : échappée sidérante aux configurations qu’impose l’assignation au code dans lequel on s’exprime.
C’est comme si le but était de nous (lecteur) perdre.
De nous donner la sensation d’une perte.
Et de faire consister dans cette sensation, comme en négatif, un toucher du réel – de donner forme, en creux, à l'intuition du sans limites.
 |
| Carnet inédit Chino fait poète, avec portrait de Leopardi |
4
Pris sous un autre angle : il y a une rêverie « poétique » (celle du lyrisme le plus banal, le moins pensé) qui assigne à la parole le but de toucher au plus près une vérité de « nature ».
Cette rêverie prescrit qu’on désépaississe le plus possible la matière verbale qui donne corps à cette vérité : que ce soit direct, qu’à terme on fasse comme si les mots n’étaient pas là.
C’est cette discrétion qui rendra le poème intéressant, la poésie bonne fille.
En somme, il faudrait médiatiser sans médiation, saisir comme immédiatement l’immédiat pensif (des opinions précipitées) ou sensoriel (« nature », « intériorité », etc.) dont on prétend faire part.
Ainsi pensée, la poésie tend à s’abolir elle-même (en tant que médiation verbale) dans le temps même où elle se produit.
Quelle énervante contradiction !
Parmi ses conséquences : tout, pour les parlants, étant médiation, ce rêve poétique de médiation sans médiation est immédiatement la proie des médiations les plus conventionnelles (mièvrerie sentimentale, pathos de l’authentique, idéalisation du naturel, éco-poésie portée par l’air du temps, troc d’opinions en boucle dans les réseaux).
Les poètes, assez souvent, prennent du coup la vessie (la médiation, le décor toujours-déjà médiatisé dit « monde », le fini des représentations) pour la lanterne (l’expérience innommée et innommable : in-finie) dont ils prétendent poursuivre la lumière de vérité pour la capturer dans quelques miroirs de mots.
Aujourd’hui, en régime de domination des vessies (en littérature comme ailleurs – et d’abord dans le champ politique), c’est cela (cette vulgate réactionnaire) qu’on voit occuper majoritairement l’espace dans les revues, les sites, les collections de « poésie ».
5
Raison de plus pour ne rien céder sur d’autres désirs. Et pour faire résolument autre chose. Quelque chose qui n’oublie pas ce que fut le projet poétique du moderne : rien moins qu’un formalisme mais des opérations de langue lancées contre les leurres de la réalité (les « apparences actuelles », disait Rimbaud : les constructions verbales placées comme des écrans d’idéologie entre le réel et nous) — pour forcer, à travers eux, des fictions passionnées de fidélité à l'expérience, de justesse.
La partie est perdue depuis longtemps, me dit-on. Sans doute. Mais du dépit qui s’attache à cette défaite on peut faire une raison de perdre davantage encore — une raison d’être encore plus perdu pour ce monde où la plupart semblent avoir oublié qu’il y a une partie à jouer contre l’assentiment au nouvel air poétique du temps. Car sous le masque de correction politique, d’altruisme civique et de fraternité moralisatrice qu’arbore ce visage rajeuni règnent comme toujours l’égocentrisme banal des poètes et leurs penchants volontiers serviles. Ne dominent pas moins qu’avant la niaiserie idéaliste, la naïveté politique, le peu de culture, le conformisme intellectuel, une inventivité formelle pour le moins timorée, la soumission aux règles du spectacle culturel et au fonctionnement de ses institutions alimentaires.
Il y a à résister aux effets de cette domination. Au moins par une certaine force d’inertie, un refus de consentement au prêt-à-penser, une résistance aux piétés. Parce que, mine de rien, il y va du sens même qu’on aura finalement donné à son travail et à sa vie — ce sens eût-il les apparences d’un non-sens désespéré.
Christian Prigent
NB : une version un peu différente de ce texte est au sommaire du numéro 72 de la revue Lignes : « Ce qui vient… »(livraison datée de février 2024).
Je remercie vivement son directeur, mon ami Michel Surya, de m’avoir invité à participer à ce numéro, dont on sait qu’il sera hélas le dernier.
Depuis sa création en 1987, Lignes a joué un rôle important dans les débats politiques, philosophiques, esthétiques et littéraires du temps. Je suis particulièrement fier d’avoir participé, même si tardivement, à cette aventure.
[1] R. Kerridge et N. Sammuels (éd.), Writing the environnement, Londres Zed Books, 1998. Cité par Michel Collot, dans « Le De Natura rerum de Francis Ponge », Cahiers Francis Ponge n° 5, 2022.
[2] On parlera même de « poétariat » : variante, adaptée au temps des réseaux dit « sociaux », de la formule ducassienne « la poésie doit être faite par tous. Non par un ».
[3] F. Hölderlin : « Dichterisch wohnet der Mensch auf dieser Erde » (Im lieblicher Bläue, 1807). « C’est en poète que l'homme habite sur cette terre ».
[4] Habiter en poète est le titre d’un essai de Jean-Claude Pinson (Champ Vallon, 1995). Mais la formule revient dans de nombreux écrits récents (Jean-Christophe Bailly, L’élargissement du poème, Bourgois, 2015 ; Michel Deguy, Ecologiques, Hermann, 2012 ; etc.).
[5] On ne voit guère ce que la poésie pourrait bien changer à l’habitation réelle de la terre par les hommes, sauf à étendre à l’infini le sens du mot et à appeler « poésie » l’invention (la fiction) de tout ce que les hommes font sur terre, avec la terre, à la terre – la poésie mise à part (la poésie comme travail de la langue et question sur la relation au monde qu’instaure le fait même de la parole)… Qu’il nous faille désormais nous occuper autrement de la terre, c’est l’évidence. Les batailles écologiques de tous ordres sont là pour ça. Mais sans qu’il soit besoin de croire et faire croire que ces travaux, ces luttes, ces inventions soient spécialement « poétiques ».
[6] « Y a-t-il sur terre une mesure ? Il n’y en a aucune ».
[7] Saussure : « La paraphrase phonique d’un mot ou d’un nom quelconque est la préoccupation parallèle [à la mesure] constamment imposée au poète en dehors du mètre » (in Conclusions).